
Pinel, ‘Libérateur des aliénés’

Un article de Jean-Marie Barbier et de Martine Dutoit
Formation et Apprentissages professionnels EA 7529 CNAM
Pratiques ou rapport aux pratiques ?
C’est le péché mignon de la plupart des analyses de pratiques professionnelles dans les métiers de l’humain (éduquer, soigner, diriger, communiquer etc.) : elles confondent souvent transformations intentionnelles, déclarées par les acteurs, et transformations effectives survenant à l’occasion des interactions entre professionnels et publics concernés. Elles sont censées refléter au plus près les activités professionnelles alors qu’elles reflètent plus globalement le rapport de ces acteurs professionnels à leur activité.
Ceci est d’ailleurs vrai plus généralement des énoncés tenus par les acteurs professionnels sur leurs activités, sur la place qu’ils s’accordent en tant que sujets dans ces activités, et c’est particulièrement vrai des promoteurs de « nouvelles pratiques ».
Ce constat se vérifie au niveau des activités individuelles comme au niveau des activités collectives. L’analyse de pratiques fonctionne souvent comme espace de communication, c’est-à-dire qu’elle apparait à l‘analyse comme une offre de signification adressée à soi-même et à autrui, voire une ostension de soi et de son activité adressée à soi-même et autrui (Sperber, Wilson, http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Pertinence-2269-1-1-0-1.html).
Ce qui est produit peut même devenir un matériau permettant un jeu d’évaluations réciproques entre champs de pratique (par exemple entre cultures de l’enseignement et cultures de la formation). On peut alors définir la pratique comme le discours tenu par un sujet sur sa propre activité et sur lui-même en activité.
Les conséquences que l’on peut en tirer sur l’usage de la référence aux champs de pratiques en sciences sociales sont considérables. Loin d’être un moyen direct d’accéder aux réalités sociales telles que les connaissent les professionnels, loin d’objectiver des ‘informations’ collectées sur les pratiques professionnelles, ces réalités sont construites à travers le prisme du vécu, de la perception, de l’interprétation de sujets engagés. Comme l’indique Merleau-Ponty et avec lui tout le courant phénoménologique « l’existence (…) c’est le mouvement par lequel l’homme (…) s’engage dans une situation physique et sociale qui devient son point de vue sur le monde » (Sens et non-sens, Gallimard, p.89, 1996).
Rendre compte de la pratique pour ce qu’elle désigne comme étant son objet
Que signifie tout d’abord la notion de champ de pratiques ?
Issue de la physique, la notion de champ a été utilisée pour désigner un ensemble de phénomènes en interaction, et pour se donner ces interactions comme objet même de la recherche.
Introduite en sociologie, elle a dès lors servi à explorer les rapports entre groupes sociaux et leur dynamique. Liée à la notion de pratique, elle sert à la fois à désigner ce qu’il est convenu d’appeler l’aspect subjectif de ces rapports, c’est-à-dire les constructions de sens qui leur sont liées, et l’aspect objectivant de ces rapports, c’est-à-dire leur réalité telle qu’on pourrait y accéder indépendamment de toute interprétation, en utilisant comme le fait par exemple P. Bourdieu le concept de position.
Prenons le cas de quelques champs considérés comme champs de pratiques par les professionnels concernés.
L’éducation comme champ de pratiques
Les définitions de l’éducation, telles qu’elles se donnent à voir socialement, sont souvent référées à des valeurs ou à des champs de valeurs. Certes le libellé de ces valeurs change, mais la référence même à des valeurs ne change pas : autonomie, achievement, désaliénation, héritage , culture, patrimoine etc.…On peut même constater un lien entre affirmation de valeurs et fréquence de systèmes d’éducation considérés par les apprenants comme autoritaires.
Analysés en termes d’activité, toutes les formes d’éducation peuvent être considérées comme des espaces d’activités spécifiquement ordonnés autour d’une transformation valorisée d’habitudes d’activité des apprenants . Apprendre, c’est faire les choses autrement, qu’il s’agisse de manières d’agir, de penser ou de dire , et voir dans cette nouvelle manière un progrès par rapport à l’activité antérieure. L’apprentissage est une transformation d’habitudes d’activité valorisée, comme nous l’avons écrit apprendre, c’est ’être plus grand dans sa tête’.
Éduquer (enseigner, former, développer les compétences), c’est donc organiser des situations ou proposer des activités dans lesquelles et par lesquelles les sujets sont susceptibles d’apprendre c’est à dire organiser des situations d’apprentissage. Selon les cas, enseigner consiste à mettre à disposition des savoirs sous une forme appropriable en faisant l’hypothèse qu’ils seront appropriés sous la forme de connaissances ; former consiste à organiser des situations de transformation de capacités ou d’attitudes susceptibles d’être transférées dans d’autres situations ; développer les compétences consiste à transformer dans le même temps et à la fois l’activité dans laquelle est engagé le sujet et le sujet lui-même.
Quels que soient les dispositifs qu’elles mettent en place, les actions éducatives se caractérisent par un couplage entre l’activité de sujets proposant des situations dont ils attendent un effet d’apprentissage et la dynamique de sujets engagés dans une démarche de transformation /construction d’eux-mêmes par et dans de nouvelles activités.
Éduquer est donc un couplage d’activité entre des personnels éducatifs et activité des apprenants.
Ainsi, l’analyse des actions éducatives ne peut se réduire à l’étude de ce que veulent bien en penser ou en dire les personnels éducatifs : leurs pensées/discours sont largement liées à leurs cultures. Contrairement à ce qui se trouve quelquefois énoncé par des spécialistes de l’enseignement, l’enseignement n’est pas une science mais une culture éducative, (Barbier J-M. The conversation, 2018 : https://theconversation.com/enseigner-nest-pas-une-science-cest-une-culture-daction-educative-90396
Cette perspective de pensée a plusieurs avantages :
- attirer l’attention sur les processus de reconnaissance des apprentissages, ce qui peut avoir de multiples effets, en particulier de reconnaissance de talents ou d’acquis non reconnus par les systèmes d’évaluation scolaire ou professionnels
- mettre en objet les interactions à des fins éducatives ; l’identification des transformations effectives des activités des apprenants ne se limite pas à leur évaluation au regard des objectifs poursuivis. Les personnels éducatifs connaissent bien ce qu’ils veulent faire ; ils connaissent moins ce qu’ils font effectivement, et c’est bien cela la difficulté, même si elle est naturelle.
Apprendre, c’est faire les choses autrement, qu’il s’agisse de manières d’agir, de penser ou de dire, et voir dans cette nouvelle manière un progrès par rapport à l’activité antérieure. L’apprentissage est une transformation d’habitude d’activité valorisée par les sujets concernés et/ou leur environnement https://www.innovation-pedagogique.fr/article8610.html
Éduquer (enseigner, former, développer les compétences), c’est donc organiser des situations ou proposer des activités dans lesquelles et par lesquelles les sujets sont susceptibles d’apprendre, c’est à dire organiser des situations d’apprentissage Selon les cas, enseigner consiste à mettre à disposition des savoirs sous une forme appropriable en faisant l’hypothèse qu’ils seront appropriés sous la forme de connaissances ; former consiste à organiser des situations de transformation de capacités ou d’attitudes susceptibles d’être transférées dans d’autres situations ; développer les compétences consiste à transformer dans le même temps et à la fois l’activité dans laquelle est engagé le sujet et le sujet lui-même.
Quels que soient les dispositifs qu’elles mettent en place, les actions éducatives se caractérisent par un couplage entre l’activité de sujets proposant des situations dont ils attendent un effet d’apprentissage et la dynamique de sujets engagés dans une démarche de transformation /construction d’eux-mêmes par et dans de nouvelles activités.
L’analyse des actions éducatives ne peut se réduire à l’étude de ce que veulent bien en penser ou en dire les personnels éducatifs : leurs pensées/discours sont largement liées à leurs cultures, contrairement à ce qui se trouve quelquefois énoncé par des spécialistes de l’enseignement, l’enseignement n’est pas une science mais une culture éducative.
Elle suppose d’une part la difficile mise en objet des organisations d’interactions à des fins éducatives, d’autre part l’identification des transformations effectives des activités des apprenants, qui ne se limitent pas à leur évaluation au regard des objectifs poursuivis. Les personnels éducatifs connaissent bien ce qu’ils veulent faire ; ils connaissent moins ce qu’ils font effectivement, et c’est bien cela la difficulté, même si elle est naturelle, et si l’expérience professionnelle et la recherche en éducation peuvent contribuer à y pallier. A bien des égards on peut reprendre à propos des professionnels des métiers de l’humain le célèbre énoncé :’ils ne savent pas ce qu’ils font’.
La direction et le management comme champ de pratiques
Contrairement à une représentation courante, héritée du modèle taylorien, diriger ne consiste pas à dire ce qu’il faut faire, mais à agir sur l’engagement d’autrui dans un cadre préalablement défini d’organisation (https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/diriger-un-travail/40299 ). Le travail réel engagé par ‘ ceux qui font ‘ dépasse singulièrement le travail prescrit.
La définition que donne Giorgio Agamben des dispositifs (2007) https://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/quest-ce-quun-dispositif-9782743628680 comme ce qui a la capacité de susciter l’activité d’êtres vivants peut être reprise pour l’ensemble des activités de production de biens et/ou de services.
La direction est un couplage entre l’activité de ‘dirigeants’ et l’activité de ‘collaborateurs’ ayant comme fonction d’agir sur l’engagement d’activité de ces derniers.
Les dispositifs sont donc des cadres préalables d’organisation des activités, fonctionnant comme autant de contraintes/opportunités pour l’activité des sujets qui s’y engagent en référence à des objectifs affichés.
Les dirigeants mettent en place les conditions d’un engagement de leurs ‘ collaborateurs ‘ dans le cadre de cette organisation préalable. Le sujet dirigeant ‘ fait agir’ dans le cadre de… en référence à… ; et il-elle contribue par des communications à la finalisation de cet agir.
Les sujets en position de collaborateurs, en contrepartie, engagent leur activité dans le cadre de cette organisation. On se trouve en fait dans une relation de double engagement ou de couplage d’engagement. Le non-respect de ces règles peut entraîner la rupture de la relation d’engagement, laquelle peut donner lieu à un contrat formel, même si ce contrat est inégal. Cette relation se définit au regard du résultat global du travail engagé.
Le soin comme champ de pratiques
Habituellement, comme pour l’éducation, l’intervention de soin ou la thérapie sont décrits en termes très axiologiques, notamment autour des notions de bien-être ou de mieux-être. Il s’est développé un lexique du soin aussi riche que le lexique de l’éducation.
Ce lexique présente évidemment la conséquence que le public visé par les actions de soin fait l’objet d’un étiquetage, destiné certes à justifier l’intervention et les moyens qu’elle mobilise, mais qui peut aussi être considérée par ce public comme stigmatisant et réducteur, , notamment lorsque ce dernier connaît une affection chronique (Dutoit, https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/etre-vu-se-voir-se-donner-a-voir/40306 ) A bien des égards on peut reprendre à propos des professionnels des métiers de l’humain le célèbre énoncé :’ils ne savent pas ce qu’ils font’.
Le soin est donc un couplage entre activité des personnels de santé et activité des patients ayant comme fonction d’agir sur le régime d’activité des patients
Une voie de caractérisation du changement recherché peut être trouvée dans la notion de régime d’activité. Pour Canguilhelm, être malade, c’est vraiment pour l’homme vivre une autre vie. La maladie, le handicap, l’affection passagère ou durable peuvent être considérés comme des paramètres de l’activité humaine, variables selon les sujets, sans stigmatisation. Le régime d’activité peut être défini comme l’ensemble des conditions, durables ou passagères, qui régissent le développement de l’activité humaine, quel qu’en soit le contenu.
Le soin peut alors être défini comme une intervention sur un régime d’activité . Le soin ou la thérapie peuvent être analysés comme un couplage d’activité entre la proposition par le sujet soignant d’une organisation de soins, et l’activité propre du sujet au service du « maintien de soi en vie » ou en activité. La « guérison » ne peut survenir sans l’activité du « patient ».
La communication comme champ de pratiques
Un couplage entre activité d’un sujet énonciateur et activité d’un sujet destinataire ordonné ayant comme fonction d’agir sur la transformation des constructions de sens du sujet destinataire
L’action de communication peut être considérée comme une action de mobilisation de signes à intention d’influence sur autrui par effet de construction de sens. Elle fonctionne comme une combinaison d’offre de significations chez le sujet communiquant et de construction de sens chez le sujet destinataire de la communication (Barbier, Rapport établi, sens construit, signification donnée in https://www.puf.com/signification-sens-formation ).
Dans les deux cas, il s’agit d’une reconstruction : reconstruction de signification chez le sujet communiquant qui, à partir de significations antérieures, produit des significations sans cesse nouvelles, et dont le destinataire doit reconnaître les intentions ; reconstruction de sens chez le destinataire à partir de son activité antérieure de construction de sens, laquelle se trouve donc infléchie par et dans l’interprétation des intentions du locuteur.
Pour Merleau-Ponty (https://www.gallimard.fr/catalogue/phenomenologie-de-la-perception/9782070293377) « Le sens des gestes n’est pas donné, mais compris, c’est-à-dire ressaisi par un acte du spectateur […] ». Dans les interactions concrètes, les mêmes sujets sont tantôt énonciateurs, tantôt destinataires, et réciproquement.
Selon les grandes catégories de couplages entre les activités du sujet communiquant et du sujet destinataire, on retrouve les grandes catégories de communication : associées dans le temps et dans l’espace comme dans la communication orale, différées dans l’espace comme dans la communication à distance, différées dans le temps et l’espace comme la mise à disposition et l’accès à des ressources. S’y ajoutent les catégories de signes mobilisées : communication de symboles, communication d’images, communication d’action, etc.
Les autres ’métiers de l’humain’ sont aussi des champs de pratiques
On pourrait ajouter le conseil qui est une intervention sur la délibération d’autrui, l’accompagnement qui est une intervention sur la gestion par autrui de sa propre activité (Vitali M-L , Barbier J-M. (2013) Le champ d’inscription du tutorat in : Cathia Papi Le tutorat de pairs dans l’enseignement supérieur), ou encore le travail social qui est une intervention sur le rapport entretenu par un sujet ou un ensemble de sujets avec son/leur environnement social, ce qui explique par exemple l’historique de l’émergence de l’action sociale (https://www.alternatives-economiques.fr/classes-laborieuses-classes-dangereuses-a-paris-pendant-premiere-moitie/00028321 ). Ou encore l’information qui peut s’analyser comme ayant une fonction de production d’une représentation partagée.
Nous faisons l’hypothèse que tous les champs d’activité identifiables par l’organisation sociale d’interactions en vue de la transformation des activités d’autrui fonctionnent comme des couplages d’activités.
Ces champs sont certes des champs d’interactions, mais ils fonctionnent aussi comme des champs d’interactivités : les interactivités sont des transformations qui surviennent du seul fait de la co-présence de plusieurs sujets, sans forcément organisation intentionnelle. Non seulement les transformations ne se limitent pas aux transformations intentionnelles mais elles touchent autant les sujets intervenants, même s’ils l’ignorent, que les sujets considérés comme destinataires. Les uns et les autres se transforment conjointement.
La fonction sociale de quelques champs professionnels
| Champ professionnel | Fonction sociale du champ professionnel |
|---|---|
| Management | Transformations de l’engagement d’activité d’autrui dans une action |
| Travail social et intervention | Transformations du rapport d’une population avec son environnement social |
| Éducation | Transformations valorisées d’habitude d’activité |
| Création | Transformations simultanées du produit de l’action, de l’action et de l’acteur |
| Communication | Transformations des constructions de sens d’autrui au moyen d’une offre de signification |
| Soin | Transformations de régime d’activité |
CONCLUSION
L’’entrée activité’ cherche à rendre compte à la fois de la dimension observable des activités, indépendamment des points de vue de sujets concernés, des sens que les sujets humains construisent autour d’’elles ou des significations qu’ils leur donnent. Elle considère que ces sens et ces significations sont des matériaux ou des objets pour la recherche et non des outils et/ou d’interprétation. Autrement dit, les sciences sociales ont tout à la fois pour objet les activités des sujets humains indépendamment de la conscience qu’ils peuvent en avoir, et les constructions mentales et discursives qu’ils édifient autour d’eux.


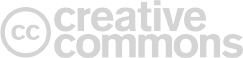
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
